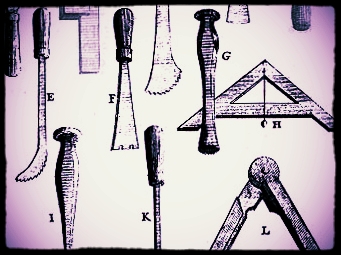Conduit durant l'année scolaire 2012-2013 dans le cadre de l'Université Conventionnelle, cet atelier de philosophie se proposait d'accompagner le public dans la lecture d'un monument de la pensée, aussi célèbre que souvent réduit à quelques formules, le Discours de la méthode de Descartes (1637).
Le résultat, ce sont ces neuf séances que vous pouvez écouter ou réécouter ici, et sous la forme de liste de lecture sur notre compte Soundcloud. Les extraits commentés sont disponibles sur cette page ou dans la bibliothèque de Septembre.
Séance du 14 novembre 2012 / "le bon sens est la chose du monde la mieux partagée"
« Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ». Telle est la première phrase du Discours de la méthode. Descartes, on le voit, ne commence pas par le plus évident, et le lecteur impatient pourrait être tenté de refermer le livre à la lecture d’une affirmation d’apparence si contraire au spectacle du monde : la bêtise et la folie y ont davantage leur part que le bon sens et la raison. Partout règne la discorde, y compris – surtout ? – chez les savants ou chez ceux que l’on n’appelait pas encore les « intellectuels ».
Mais Descartes distingue la raison, qui est universelle, et l’usage de la raison, qui suppose la volonté de bien en user. Ainsi, plus tard dans l’ordre de la lecture, la méthode cartésienne se donnera pour première règle de n’accepter pour vrai que ce que nous savons reconnaître comme tel : la (fausse) évidence de ce précepte révèle qu'il s'agit là davantage d'une règle de la volonté que d’une règle de l’entendement. La logique ou la validité de nos raisonnements sont une condition nécessaire à la pensée mais ne suffisent pas: pour penser correctement, il faut encore pouvoir faire abstraction de nos passions et de nos intérêts, de nos peurs et de nos désirs. C’est pourquoi l’exigence de la pensée est aussi une exigence morale. Tout comme cette première page du Discours est d'abord un appel à user de notre bon sens, universellement partagé mais si souvent dévoyé.
Après une brève présentation du projet de Descartes, cette première séance s’attachera à la lecture et à l’explication de la première page du Discours de la méthode, disponible ici.
Séance du 28 novembre 2012 / La crise de la culture
« J’ai été nourri aux lettres dès mon enfance, et pour ce qu’on me persuadait que, par leur moyen, on pouvait acquérir une connaissance claire et assurée de tout ce qui est utile à la vie, j’avais un extrême désir de les apprendre. Mais sitôt que j’eus achevé tout ce cours d’études, au bout duquel on a coutume d’être reçu au rang des doctes, je changeais entièrement d’opinion. » Descartes, Discours de la méthode, Partie I.
La première partie du Discours de la méthode porte en son coeur une critique de la culture que le lecteur, à force d'en entendre, pourrait somme toute trouver assez commune. Descartes y accuse l'enseignement du Collège de La Flèche de ne l'avoir conduit qu'au doute et à l'erreur. D'aucuns pourraient même voir, dans cette revendication d'un enseignement utile à la vie, une forme de "modernité": l'appel d'un homme - qui fut aussi un scientifique - à laisser de côté les vaines élucubrations des lettres, ou de ce que l'on appelait autrefois les Humanités.
Mais, alors, comment comprendre que le seul reproche que Descartes fasse à l'enseignement des mathématiques soit de n'être bon qu'à former des ingénieurs? En vérité, il nous faut, pour pouvoir entendre ce texte, nous défaire de ce que notre époque a fait de la notion d'utilité comme de celle de culture. Car Descartes ne s'en prend aux Humanités que dans la mesure où celles-ci trahiraient la promesse de leur nom et ne feraient pas encore suffisamment de nous des hommes.
Parce qu'il reviendra à s'interroger sur la notion d'instruction, le passage commenté lors de cette séance peut être mis en parallèle avec L'Emile, le grand livre de Rousseau sur l'éducation. On en retiendra notamment l'idée, exprimée dans cet extrait, qu'un apprentissage sans méthode ne forme pas seulement des ignorants, mais des dupes et des esclaves :
« Que l’enfant ne fasse rien sur parole : rien n’est bien pour lui que ce qu’il sent être tel. En le jetant toujours en avant de ses lumières, vous croyez user de prévoyance, et vous en manquez. Pour l’armer de quelques vains instruments dont il ne fera peut-être jamais d’usage, vous lui ôtez l’instrument le plus universel de l’homme, qui est le bon sens ; vous l’accoutumez à se laisser toujours conduire, à n’être jamais qu’une machine entre le mains d’autrui. Vous voulez qu’il soit docile étant petit : c’est vouloir qu’il soit crédule et dupe étant grand. Vous lui dites sans cesse : « Tout ce que je vous demande est pour votre avantage ; mais vous n’êtes pas en état de le connaître. Que m’importe à moi que vous fassiez ou non ce que j’exige ? C’est pour vous seul que vous travaillez. » Avec tout ces beaux discours que vous lui tenez maintenant pour le rendre sage, vous préparez le succès de ceux que lui tiendra quelque jour un visionnaire, un souffleur, un charlatan, un fourbe, ou un fou de toute espèce, pour le prendre à son piège ou pour lui faire adopter sa folie. » Rousseau, Emile, Livre III
Séance du 12 décembre 2012 / Le grand livre du monde
Cette séance sera consacrée à l'étude de la fin de la première Partie du Discours de la Méthode: Descartes y quitte les livres pour voyager.
Il est tentant d'interpréter ce passage comme une nouvelle apologie de l’expérience contre le raisonnement, ou de l'homme d'action contre l'intellectuel. Là encore, l'argument est bien connu : comme le disent les refrains de chansons populaires, il y a des choses qui ne s’apprennent pas dans les livres...
Pourtant ce serait oublier que le grand livre du monde est toujours un livre : Descartes ne se jette pas dans le monde pour y faire des affaires et arrêter de penser, mais au contraire pour continuer son étude et mieux penser. Et si l'observation du monde lui paraît préférable au monde des savants, c'est que ces derniers ne risquent pas grand chose à se tromper et que, conduits par la vanité de se distinguer, ils préfèreront toujours défendre une absurdité inédite que partager une vérité trop connue. Ce qui engendre l’erreur dans le monde intellectuel n’est donc pas de se placer dans l’intellect, mais bien dans le passionnel : les monstruosités de la pensée spéculative ne résultent pas d'un excès de raison et d'intelligence, comme on l'entend parfois (et souvent chez les "intellectuels" même), mais de la perversion de la raison et de l’intelligence par nos désirs.
Au cours de cette séance, deux pages de littérature furent évoquées. Il s'agit d'un tableau de La Vie de Galilée, de Brecht, et d'un passage de Bouvard et Pécuchet de Flaubert. Les deux textes sont téléchargeables ci-dessous.
Séance du 23 janvier 2013 / L'idée de fondation
La Partie II du Discours de la méthode relate le tournant du 10 novembre 1619 : Descartes, enfermé dans son poêle en Allemagne, enchaîne les pensées qui vont le conduire à l'idée d'une science universelle et aux règles de la méthode. Mais, pour en arriver là, il nous faut d'abord saisir en quoi la science véritable est nécessairement une.
L'hétérogénéité des savoirs -responsable de la déception décrite dans la Partie I du Discours de la méthode - n'est pas gage de spécialisation ou "d'excellence", comme on le dirait aujourd'hui, mais résulte plutôt de notre impuissance à comprendre de ce qui devrait faire leur unité. La diversité des sciences exprime notre ignorance: nous les distinguons parce que nous renonçons à comprendre ce qui les lie et donc les constitue en savoir. Savoir, c'est savoir pourquoi. L'exigence d'unité appelle à son tour la nécessité d'une refondation.
Mais le projet de fonder son savoir n'est pas une entreprise comme une autre. Car fonder ne signifie pas seulement consolider, mais reconstruire à neuf: c'est une construction qui suppose d'abord une destruction. Il importe donc de comprendre également en quoi ce projet ne peut être qu'individuel.
Ce commentaire de la première moitié de la Partie II du Discours de la méthode s'appuiera sur un extrait des Règles pour la direction de l'esprit.
Séance du 6 février 2013 / les règles de la méthode
Le titre de cette cinquième séance est volontairement réducteur. Dans la seconde moitié de la Deuxième Partie du Discours de la méthode, Descartes énumère quatre règles ou "préceptes" à observer pour conduire ses pensées. Cet énoncé de la fameuse méthode n'est cependant pas sans poser plusieurs problèmes, car, pour commencer, s'il n'y avait qu'à connaître ces règles pour bien penser, les Descartes devraient être plus nombreux ou, comme on le dit plus vulgairement, "cela se saurait"... Formellement, comment même expliquer la structure et la longueur du Discours si quatre préceptes suffisent?
Par ailleurs, il est courant d'entendre que la méthode cartésienne suit ici un "modèle mathématique". Il est vrai que, comme nous l'avions vu dans la Première Partie, les mathématiques échappaient à la critique cartésienne « à cause de la certitude et de l’évidence de leurs raisons ». Pour autant, une lecture attentive du texte nous montre au contraire un Descartes qui, après avoir congédié la logique, se plaint des défauts de la géométrie et de l'algèbre. Les mathématiques lui semblent si imparfaites qu'il les réformera pour donner lieu à ce que l'on nommera plus tard la géométrie analytique. Descartes voulait des mathématiques dignes de son projet philosophique: s'il nous faut commencer par elles, c'est parce que nous devons réapprendre à penser et aller à rebours de l’enfance, de cette nature que le temps nous a donnée et qui consiste à affirmer sans savoir et sans comprendre. Les mathématiques n’ont donc aucune supériorité en tant que discipline. Au contraire, Descartes ne cesse de rappeler qu’elles ne servent à rien parce qu’elles ne parlent pas de la vie. Mais, pour cela aussi qui désamorce bien des passions, elles nous entraînent à penser droitement et tendent à restaurer la raison.
Cette séance, qui nous conduira à examiner ce qu'il faut entendre par l'ordre des raisons, s'achèvera sur un premier commentaire de la célèbre comparaison cartésienne entre la philosophie et un arbre. En voici le texte :
« Ainsi toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale ; j’entends la plus haute et la plus parfaite morale, qui, présupposant une entière connaissance des autres sciences, est le dernier degré de la sagesse. Or comme ce n’est pas des racines, ni du tronc des arbres, qu’on cueille les fruits, mais seulement des extrémités de leurs branches, ainsi la principale utilité de la philosophie dépend de celles de ses parties qu’on ne peut apprendre que les dernières. »
Descartes, Lettre-Préface des Principes de la philosophie
Séance du 20 février 2013 / La morale par provision
Adopter le doute cartésien est analogue à décider de détruire son logis pour s'en bâtir un meilleur. La partie II du Discours de la méthode soulignait les risques de cette entreprise et s'assurait de la méthode pour reconstruire à neuf. Mais l'ennui est que, pendant qu'on pense, il faut bien vivre, et qu'avant de savoir la manière dont il faudrait vivre, il faut finir de penser...
Pour répondre à ce cercle, Descartes conçoit donc une "morale par provision", c'est-à-dire une morale provisoire, conçue comme un abris "où on puisse être logé commodément pendant le temps qu'on y travaillera".
Séance du 20 mars 2013 / Du doute au cogito
Cette séance portera sur la plus célèbre thèse de Descartes: le fameux "je pense donc je suis", énoncé dans la quatrième partie du Discours de la méthode et résumé sous l'expression de "cogito cartésien" en raison de sa version latine ( "cogito ergo sum").
NB: En raison d'une étourderie de ma part, cette séance n'a pu être enregistrée. En lieu et place du fichier audio, je mets en ligne une version abrégrée de mes notes de cours, tout en ayant conscience de l'imperfection de cette solution...
Séance du 22 avril 2013 / Du doute à l'existence de Dieu
Cette séance poursuit la réflexion métaphysique initiée dans l'atelier précédent et se propose d'explorer la métaphysique cartésienne à partir du résumé qu'en fournit la quatrième partie du Discours.
Séance du 29 avril 2013 / Descartes et la science
De manière un peu éhontée, cette dernière séance portera sur les parties V et VI du Discours de la méthode. Cependant cette accélération soudaine de notre rythme de lecture ne s'explique pas seulement par les impératifs du calendrier et le mauvais calcul du professeur: la fin du Discours, qui traite de la science, est moins dense que les parties précédentes. Cela, bien sûr, ne signifie pas pour autant que le propos y est moins important: il s'agira de comprendre quelle révolution scientifique entraîne la pensée cartésienne.